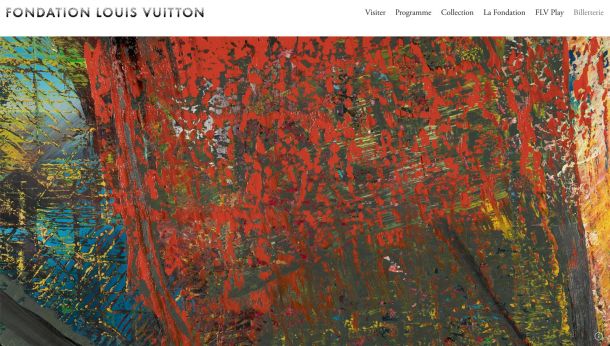Les femmes photographes dans l’histoire de la photographie

Jeux d’Ô – Houle – Photo : © Éléonore Mehl
Des pionnières de l’époque victorienne aux artistes d’aujourd’hui, les femmes photographes ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de la photographie. Elles ont inventé des langages visuels, pris des risques physiques, raconté ce que personne ne voulait voir. Elles ont aussi prouvé que l’image pouvait être un espace de pouvoir.
Sommaire
- Pionnières (1840, 1910)
- Modernes et avant-gardes (1910, 1945)
- Après-guerre et grands récits (1945, 1970)
- Révolutions des regards (1970, 2000)
- Générations contemporaines (2000 – aujourd’hui)
- Une réalité actuelle : pourquoi les femmes sont encore moins visibles dans les galeries
- Focus : Éléonore Mehl, du grand format à l’instant poétique
- Thèmes majeurs et héritage
- Conclusion
Mais malgré cette histoire riche, la reconnaissance reste incomplète.
Même aujourd’hui, une galerie comme « Une image pour rêver », qui défend la photographie d’art en tirages limités, reçoit beaucoup plus de candidatures de photographes hommes que de photographes femmes. Les hommes prennent spontanément contact, proposent leur travail, se projettent immédiatement dans la vente d’art. Les femmes photographes se présentent beaucoup moins souvent, et beaucoup plus tard dans leur parcours. Ce décalage existe encore en 2025.
C’est pourquoi la galerie assume une position claire : donner de la place à des regards féminins, sans les enfermer dans une case “féminin”. Aujourd’hui, la galerie représente le travail d’Éléonore Mehl aux côtés de six photographes hommes. Ce chiffre, à lui seul, dit deux choses : le chemin parcouru, et le chemin qu’il reste à faire.
Pionnières (1840, 1910)
Au milieu du XIXe siècle, alors que la photographie est encore un procédé complexe et technique, des femmes s’en emparent immédiatement.
Anna Atkins, en Angleterre, publie dans les années 1840 des cyanotypes botaniques. Son travail est considéré comme l’un des premiers livres entièrement illustrés par des images photographiques. Elle n’est pas “l’assistante de”, elle est l’autrice.
Julia Margaret Cameron, dans les années 1860, révolutionne le portrait. Elle travaille la lumière comme une matière, accepte le flou, recherche l’émotion plutôt que la perfection technique. À une époque obsédée par la netteté, elle impose le sensible.
En France, le nom de Nadar reste célèbre. Mais derrière Nadar, il y a aussi Ernestine et Adrienne Tournachon (dite Nadarine), qui travaillent dans le studio, gèrent les prises de vue et participent à la fabrication de cette renommée.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de nombreuses femmes dirigent leur propre studio, surtout dans les villes de cure, de villégiature ou les capitales industrielles. La photographie devient pour elles un métier, une autonomie financière, parfois une indépendance sociale. Être photographe est déjà un acte d’émancipation.
Modernes et avant-gardes (1910, 1945)
Le XXe siècle change tout, la photographie devient à la fois un outil artistique, politique et journalistique, et les femmes y prennent leur place.
Imogen Cunningham, aux États-Unis, membre du groupe f/64, photographie la matière, la plante, le métal, la peau. Elle impose une esthétique précise, sensuelle et géométrique.
Tina Modotti fait de la photographie un outil révolutionnaire au Mexique. Son travail se situe à la frontière entre poésie visuelle et militantisme politique.
Gerda Taro couvre la guerre d’Espagne dans les années 1930. Elle est considérée comme la première photographe de guerre morte au front. Beaucoup de ses clichés ont longtemps circulé sous le nom de Robert Capa. Il a fallu des décennies pour réattribuer ses images.
Berenice Abbott documente New York en pleine mutation. Elle photographie l’architecture, la verticalité, la vitesse de la ville moderne.
Lisette Model, elle, tourne son objectif vers les corps réels, les visages sans filtre. Elle refuse le glamour mensonger. Elle photographie l’humain, tel qu’il est, avec une intensité parfois dérangeante.
Ces femmes ne se contentent pas “d’illustrer le monde”. Elles redéfinissent ce que la photographie a le droit de montrer.
Après-guerre et grands récits (1945, 1970)
Après la Seconde Guerre mondiale, la photographie devient mémoire. Témoigner devient vital.
Lee Miller est emblématique. Mannequin au début de sa vie, muse dans le cercle surréaliste, elle devient correspondante de guerre. Elle photographie la libération de Paris, les camps nazis après leur ouverture. Ses images ne sont pas seulement historiques. Elles portent aussi la trace du choc psychologique.
Margaret Bourke-White signe des reportages majeurs pour le magazine Life. Elle photographie l’industrie lourde américaine, Staline, Gandhi, l’apartheid. Elle incarne cette génération de femmes qui franchissent les portes des lieux “réservés aux hommes”.
Dorothea Lange, connue pour ses images de la Grande Dépression, continue après-guerre à documenter l’injustice sociale avec une humanité qui n’est jamais naïve.
En France, Sabine Weiss et Martine Franck portent un regard tendre mais lucide sur le quotidien. On parle souvent de “photographie humaniste” pour les qualifier, mais ce n’est pas de la gentillesse esthétique. C’est une vraie façon de dire : chaque personne compte.
Révolutions des regards (1970, 2000)
À partir des années 70, les frontières explosent, documentaire, fiction, autoportrait, performance, tout se mélange.
Diane Arbus photographie celles et ceux que la société marginalise, artistes de freak shows, travestis, gens qu’on juge “hors norme”. Elle force le spectateur à regarder ces personnes en face, sans les réduire à une curiosité.
Cindy Sherman prend sa propre image comme champ d’expérimentation. Elle se met en scène dans des rôles codés (la femme fragile, l’ingénue, la victime de film noir, etc.) pour démonter la manière dont la culture fabrique l’image de “la femme”.
Nan Goldin chronique sa vie et celle de ses proches, amour, amitié, désir, dépendance, violence intime, sida. Elle documente des communautés (LGBTQ+, artistes, personnes séropositives) que les médias d’alors invisibilisent ou caricaturent. Son travail fait du privé un espace politique.
Sarah Moon réinvente la photo de mode, elle ne vend pas seulement un vêtement, elle raconte une atmosphère. Flou, textures, nostalgie, beauté fragile. Elle impose une poésie visuelle qui influence jusqu’à aujourd’hui.
Bettina Rheims interroge le corps, le désir, le genre, la puissance du féminin. Elle joue avec les codes de la séduction et les retourne.
Jane Evelyn Atwood s’engage dans des sujets très durs sur la durée, femmes incarcérées, prostitution de rue, handicap, blessures de guerre. Elle prend le temps de comprendre avant de montrer.
Et puis, phénomène à part, Vivian Maier. Nourrice à Chicago, elle photographie toute sa vie sans jamais chercher la reconnaissance. Ses négatifs ont été découverts après sa mort, révélant une œuvre immense, une street photography subtile, drôle, tendre, incroyablement construite. Elle prouve que des œuvres majeures peuvent rester invisibles simplement parce qu’aucune institution ne s’est penchée dessus.
Générations contemporaines (2000, aujourd’hui)
Aujourd’hui, l’idée de “photographie féminine” ne veut pas dire “un style féminin”. Elle veut dire, des femmes qui occupent l’espace visuel, sans demander l’autorisation.
Graciela Iturbide, au Mexique, explore les identités culturelles, les rituels, la spiritualité. Son travail oscille entre documentaire et mythe.
Zanele Muholi, en Afrique du Sud, parle de “visual activism”. Ses portraits dignes, directs, puissants, donnent une visibilité fière aux personnes LGBTQIA+. Là, le portrait n’est pas décoratif. C’est une affirmation d’existence.
LaToya Ruby Frazier documente sa propre famille et les villes post-industrielles américaines. Elle photographie les effets du racisme structurel, de la fermeture des usines, de l’abandon politique. C’est à la fois social et intime.
Rinko Kawauchi, au Japon, s’intéresse au presque rien, un oiseau en vol, la lumière du matin sur une table, une main d’enfant. Elle rappelle que la poésie visuelle n’est pas mineure. Elle est essentielle.
En Europe, on peut citer Valérie Belin, Hannah Starkey, Leila Alaoui (disparue en 2016), ou SMITH. Elles travaillent sur l’identité, la représentation du corps, la migration, le rapport au territoire. Certaines utilisent la mise en scène sophistiquée. D’autres restent dans le réel. Beaucoup brouillent volontairement la frontière entre les deux.
Ce qui a changé aussi depuis les années 2000, c’est le contrôle. Les photographes femmes publient leurs propres livres, montent leurs expositions, s’auto-archivent, se diffusent via les réseaux. Elles n’attendent plus qu’une institution valide leur existence.
Une réalité actuelle, pourquoi les femmes sont encore moins visibles dans les galeries
On pourrait croire qu’en 2025, tout ça est réglé. Pas vraiment.
Dans la pratique, beaucoup de galeries reçoivent toujours une majorité de candidatures masculines. C’est exactement ce que constate la galerie “Une image pour rêver”.
Les chiffres internes montrent un déséquilibre très net, pour une femme qui se présente pour être exposée, il y a environ six hommes. Les hommes photographes osent se proposer, envoyer des dossiers, parler prix, parler reconnaissance, parler collection. Les femmes, elles, se présentent moins souvent, alors même que leur travail est au niveau.
Ce n’est pas un problème de qualité. C’est un problème d’accès, de confiance, parfois d’autolégitimation. Certaines femmes photographes ont derrière elles une carrière de vingt ou trente ans et n’ont jamais “pensé galerie” pour leurs images personnelles. Elles ont fait le travail, mais pas la revendication.
C’est précisément là qu’une galerie a un rôle. Pas pour remplir des quotas. Mais pour ne pas laisser passer des voix essentielles.
Focus, Éléonore Mehl, du grand format à l’instant poétique
Parmi les artistes représentées par la galerie “Une image pour rêver” figure Éléonore Mehl, photographe française et fondatrice du studio Tamos.
Née à Nancy, dans l’est de la France, elle grandit en région parisienne avant d’intégrer l’École des Gobelins à Paris, une référence mondiale en matière d’image. Elle en sort diplômée en 1988, section photographie, prise de vue.
Elle débute ensuite sa carrière aux côtés du duo Bernard et Sophie Rossi, fondateurs du Studio Bernard Rossi. Ce studio collabore avec de grandes agences et de grands magazines, notamment autour de la nature morte, de la photographie d’objets et de personnages en situation. Pendant près de dix ans, Éléonore y développe une exigence absolue sur la lumière, la précision et la composition. Elle apprend la rigueur du studio haut de gamme.
En 1998, forte de cette expérience, elle crée son propre studio. Elle y déploie tout son savoir-faire en photographie grand format, plus particulièrement dans les univers de la beauté et du luxe. Son style, des images techniquement impeccables, élégantes, raffinées, mais jamais froides. Elle devient une référence dans un milieu où la maîtrise technique est non négociable.
Puis, bascule. En 2017, un jour de pluie, elle réalise une image avec… un iPhone. Rien de lourd. Pas de chambre grand format. Pas de flashs complexes. Juste un geste, un regard, une goutte. Cet instant déclenche la série “Jeux d’Ô”.
“Jeux d’Ô”, c’est autre chose. Ce n’est plus la commande commerciale. C’est la liberté personnelle. Elle y explore l’eau, la trace, le flou, la transparence, la matière, jusqu’à l’abstraction poétique. Les reflets deviennent des tableaux. La pluie devient quasiment de la calligraphie visuelle. On ne décrit plus la réalité, on la ressent.
Depuis, Éléonore Mehl poursuit ce travail personnel comme un laboratoire intime. En studio ou en extérieur, elle cherche la poésie du réel, la beauté fragile d’un instant qui n’existe qu’une fois. Elle laisse passer l’accident, le mouvement, l’imperfection vivante. On est entre minimalisme et émotion pure.
C’est exactement ce regard que la galerie “Une image pour rêver” veut rendre visible, un regard de femme photographe qui a traversé la technique, la commande, l’exigence lumière et matière, et qui revendique désormais une expression plus libre, plus intérieure, plus sensible.
Thèmes majeurs et héritage
Briser les cadres techniques
Les femmes ne sont pas seulement des modèles ou des assistantes. Elles manipulent les procédés, inventent des méthodes, travaillent la lumière, expérimentent les supports.
Réinventer le portrait
De Julia Margaret Cameron à Cindy Sherman, le portrait devient un espace où l’identité est questionnée, performée, reconstruite. On n’est plus dans “voici son visage”, mais “voici comment on se présente au monde, ou comment le monde nous fabrique”.
Faire du privé un espace politique
Tina Modotti, Nan Goldin, Zanele Muholi, LaToya Ruby Frazier, toutes prouvent qu’un corps, une famille, une communauté, une douleur intime peuvent devenir acte de parole publique. Montrer sa vie devient une forme de résistance.
Réparer l’oubli
Longtemps, l’histoire officielle de la photographie a tout simplement effacé, minimisé ou invisibilisé de grandes photographes. Aujourd’hui, expositions, livres, galeries et archives travaillent à rééquilibrer cette histoire. Ce n’est pas de la réécriture. C’est de la restitution.
Conclusion
L’histoire de la photographie ne se résume pas à quelques grands noms masculins. Elle est traversée par des femmes qui ont pris la parole en images, souvent sans autorisation, parfois sans protection, et presque toujours sans garantie de reconnaissance.
Aujourd’hui encore, on constate une réalité simple, les galeries reçoivent massivement des dossiers d’hommes, beaucoup moins de femmes. Résultat, la visibilité reste déséquilibrée.
C’est pour cela qu’il faut continuer à exposer, publier, raconter et défendre ces regards féminins. Pas comme une “catégorie à part”, mais comme ce qu’ils sont vraiment, une part essentielle, fondatrice, vivante, de l’histoire de la photographie.
Et tant que ce déséquilibre existe, le rôle d’une galerie comme “Une image pour rêver” est aussi de dire très clairement, ces voix existent. Elles sont là. Elles méritent d’être vues sur vos murs.